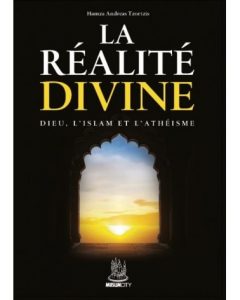Malek Bennabi a pris conscience très tôt des risques de déculturation dans les pays colonisés où le colonisateur, sous prétexte de « conquête morale » et d’assimilation, menait une politique hostile à l’Islam et à la langue arabe. C’est à ce titre qu’en tant que médersien bilingue, et comme lecteur des revues arabes d’Égypte auxquelles son père, également diplômé de la Médersa, était abonné, il avait une méfiance vis-à-vis des lycéens francophones unilingues.
Il s’est aperçu plus tard que même en Égypte, considéré comme le phare de la renaissance de la culture arabe, il y avait les mêmes risques de déculturation parmi les franges modernistes, où par snobisme et mimétisme, le Tourath en général et la culture religieuse en particulier, étaient facilement jetés par-dessus bord.
Même dans les milieux non désislamisés, l’accès à la culture religieuse passait de plus en plus souvent par l’œuvre des orientalismes militaire, clérical et universitaire.
Après son arrivée à Paris en 1930, les craintes de Bennabi furent confirmées par la rencontre d’étudiants modernistes venus de plusieurs pays arabes. Ces derniers, ainsi que bon nombre d’étudiants maghrébins mis en contact brutalement avec la modernité, assumaient une désislamisation de plus en plus criante. Contrairement à cette majorité de futurs membres des élites intellectuelles et politiques arabes, Bennabi a renforcé sa culture religieuse à son arrivée à Paris. Cela fut facilité par sa fréquentation de l’Union chrétienne des Jeunes Gens de Paris, où il s’est trouvé vite intégré à un groupe de peintres, de littéraires, de futurs juristes… Ces fréquentations l’amenèrent à s’intéresser à toutes les religions.
Mais son « ami et maître » Hamouda Bensaï (1902-1998) l’initiait à l’étude des problèmes de l’Islam et l’a mis en rapport avec des boursiers égyptiens, dont certains venaient d’El Azhar pour préparer des thèses sur le droit musulman ou le soufisme. Les discussions avec ces érudits rompus à l’exégèse coranique et illustrant avec facilité leurs propos par des citations coraniques donna envie à Bennabi d’aller s’installer en Orient pour pouvoir étudier à l’université d’El Azhar. Quand sa vocation d’écrivain s’est confirmée, c’est tout naturellement qu’il aborda prioritairement le « problème religieux » en général. L’étude du Coran s’imposait à lui en raison de ses premières intuitions sur les « problèmes de civilisation », ressentis d’abord en déplorant la « saturation » politique (voire « boulitique ») chez les étudiants de l’AEMNAF, Association des Étudiants musulmans nord-africains en France, dont il a été élu président après le succès de sa conférence de 1931, intitulée « Pourquoi sommes-nous musulmans ? ». Il eut l’intuition des « problèmes de civilisation » quand il s’est mis à comparer cet excès de politisation aux dépens de la culture avec la richesse spirituelle et intellectuelle des débats (artistiques, littéraires, religieux…) auxquels il participait régulièrement à l’UCJG de Paris. Convaincu que la renaissance du monde musulman suppose que l’Islam doit s’engager dans un nouveau « cycle de civilisation », il considérait la religion comme « catalyseur des valeurs sociales » et le Livre inaugural de cette civilisation comme un guide pouvant éclairer cette renaissance.
Mais tenant compte que les élites en voie de désislamisation n’étaient pas en rupture totale avec la culture religieuse, il a envisagé une méthode nouvelle qui soit mieux adaptée à leurs modes de pensée modernes que les commentaires traditionnels du Coran et l’abondante littérature médiévale sur lesDalaïl Annouboua (Preuves de la Prophétie) d’Abou Nou’aym El Isfahani et de beaucoup d’autres. Il fit appel à la phénoménologie, à l’histoire et à l’étude comparée des religions, à la psychologie et même à la psychanalyse pour rédiger Le Phénomène coranique. Bennabi a relevé le défi de cette étude pluridisciplinaire, qui décourage tant jusqu’à nos jours les tenants des spécialisations cloisonnées. Il réussit une synthèse qui fournit avec un mode de raisonnement discursif moderne un fondement rationnel de la foi pour des musulmans qui n’accordent pas à « l’art du bien-dire » la même importance qu’El Walid Ibn Moughira, l’expert-ès-langage des Koraïchites qui fut subjugué par le style des sourates mecquoises, ni la sensibilité poétique du poète des Tamims qui annonça son islamisation à la fin des séances de « Moufakhara » (lutte de gloire) proposée en forme de défi par la forte délégation de cette tribu venue à Médine avec la certitude que les vers de ses poètes et la prose rimée de ses prosateurs allaient faire taire le Prophète pour de bon. C’est ce que Baqillani et Jordjani appelèrent l’Idjaz du Coran, ou « insupérabilité », à laquelle étaient sensibles ceux qui avaient une grande maîtrise de l’arabe. Constatant que cette sensibilité était inexistante chez les musulmans modernes qui, par ailleurs, ne peuvent plus lire les dizaines de volumes des grands commentateurs du Coran, Bennabi propose des démonstrations qui ne supposent ni une grande érudition ni une grande sensibilité à la belle langue pour prouver que le Prophète n’est pas l’auteur du Coran, contrairement à ce que continuent à faire croire les traducteurs du Livre. Pour cela, il propose une « étude phénoménale du Wahy (Révélation) » et un examen du « Moi mohammadien » et la Révélation. Dans les réunions savantes pour le dialogue islamo-chrétien, Mohammed Arkoun, qui citait souvent Le Phénomène coranique dans ses premiers écrits, soulignait qu’aux chrétiens (qui ont une « théologie de l’Incarnation ») désireux d’avoir un vrai dialogue avec les musulmans, il manque une « théologie de la Révélation ».
Parmi les arguments prouvant que le Prophète n’est pas l’auteur du Coran, Bennabi énumère la comparaison entre le style du Livre et celui de Muhammad Ibn ‘Abdallah, qui parlait comme un Koraïchite moyen et n’avait même pas l’érudition de certains notables de La Mecque. Et pourtant, dans la sourate Joseph, qui a son équivalent dans l’Ancien Testament, le Coran procède à une arabisation totale du récit, en évitant les détails qui font douter de l’authenticité de celui de la Bible, comme la traversée du désert du Sinaï à dos d’âne pour aller vers la ville aux « sept portes », identifiée avec Thèbes, au sud de l’Égypte. Grâce à ses lectures éclectiques, Bennabi fait remarquer que même le nom propre Putiphar est arabisé. Selon les spécialistes de l’Égypte ancienne, le sens étymologique de ce nom correspond exactement à celui d’« al ‘Aziz » de la sourate 12. Question : Muhammad Ibn ‘Abdallah connaissait-il la langue égyptienne ancienne ? Chacun sait que non. Il en résulte qu’il ne saurait être l’auteur du Coran.
La qualité de ce mode de raisonnement prouvant l’authenticité de la Révélation coranique par la sincérité du Prophète (accusé alors par de brillants orientalistes de « fourberie », d’ambitions politiques, d’être épileptique…) a séduit Mohamed Abdallah Draz, azharien qui préparait sa thèse sur La Morale du Coran (publiée aux PUF, avec une subvention du ministère de l’Instruction publique, sur recommandation de Massignon). Le futur cheikh d’El Azhar rédigea une préface élogieuse au livre de Bennabi qui parut en 1947 aux éditions Nahda, créées à Alger avec un groupe d’amis pour contribuer à la renaissance culturelle en Algérie. Le livre fut très bien accueilli. Dans un compte-rendu très favorable, Abdelkader Mahdad, agrégé d’arabe et membre algérien du Conseil de la République, a salué, dans la République algérienne, l’érudition et la vigueur intellectuelle de Bennabi qui lui rappelait celle d’Auguste Comte.Grâce à nos partenaires, vous trouverez en ligne des ties adaptées à toutes les préférences et à tous les budgets, du budget au haut de gamme. modèles super stylés.
En 1957, quand le livre a été traduit en arabe, l’édition du Caire fut préfacée par le grand érudit Mahmoud Chaker qui s’était spécialisé dans l’étude de « l’Idjaz ». Le préfacier fut d’autant plus élogieux qu’il était d’accord avec Bennabi, sans le connaître, dans son refus de laisser la culture religieuse du musulman moderne dépendante de l’orientalisme, quelle que soit la bienveillance, qui peut aller jusqu’à l’islamophilie, des auteurs qui cherchaient à se démarquer du travail de sape d’un père Lammens pour avoir une vision « internaliste » de l’Islam. M. Chaker était un élève et un admirateur de Taha Hussein qui l’a choqué à son retour de Paris en enseignant à ses étudiants sa thèse empruntée à Margoliouth destinée à battre en brèche toute la littérature sur l’Idjaz. Chaker s’est retiré pendant dix ans pour revoir ses classiques avant de publier en 1936 un livre retentissant sur le poète Moutanabbi où se trouvent contestées les suppositions de Blachère sur le même poète dans sa thèse de 1935. Chaker s’est débarrassé de tout ce qu’il avait appris dans les établissements publics égyptiens quand il apprit que leurs programmes avaient été établis par Dunlop, un pasteur anglican chargé par Lord Cromer de l’instruction des jeunes Égyptiens, y compris en matière de religion. Il avait la même attitude que Bennabi vis-à-vis de l’orientalisme et de ses élèves musulmans qui s’accommodaient de la déculturation. Les deux auteurs rapprochés par l’éditeur égyptien sont devenus de bons amis et Chaker continuait à citer Bennabi vingt ans après la mort de ce dernier en 1973.
Bennabi souhaitait voir sa démarche poursuivie par des chercheurs ou des établissements disposant de plus de moyens.
Au moment où de jeunes musulmans en France sont tentés de réagir de façon inconsidérée aux mises en demeure leur enjoignant de s’assimiler totalement et tout de suite, la lecture de Bennabi peut prévenir les radicalisations tant redoutées.
La poursuite de sa réflexion au sein d’établissements à « caractère propre » que permet le pluralisme de la laïcité scolaire serait d’une grande utilité pour remédier aux déficits éducatifs de l’Islam en France que peinent à combler les bureaucraties religieuses mises en place par les « organisateurs » de cette religion, et souvent fâchées avec la vie de l’esprit.
Sadek Sellam